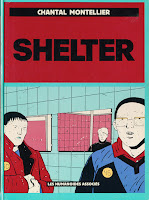Il n'est pas rare que des liens se fassent inconsciemment lorsque je commence à lire un livre. En quelques pages, l'une ou l'autre référence personnelle s'impose. "Dans la cage" de Kevin Hardcastle m'a directement renvoyé à Essex County et Roughneck/Winter Road (cette triste manie de traduire un titre en anglais par un autre titre anglais, de préférence sans grand rapport avec l'histoire...) de Jeff Lemire. A l'instar de ces 2 romans graphiques, le premier roman de Kevin Hardcastle nous emmène dans une de ces petites villes du Canada, triste banlieue sans perspective. Comme ceux de Jeff Lemire, les personnages de Kevin Hardcastle subissent l'ostracisme lié à leurs racines indiennes.
Il n'est pas rare que des liens se fassent inconsciemment lorsque je commence à lire un livre. En quelques pages, l'une ou l'autre référence personnelle s'impose. "Dans la cage" de Kevin Hardcastle m'a directement renvoyé à Essex County et Roughneck/Winter Road (cette triste manie de traduire un titre en anglais par un autre titre anglais, de préférence sans grand rapport avec l'histoire...) de Jeff Lemire. A l'instar de ces 2 romans graphiques, le premier roman de Kevin Hardcastle nous emmène dans une de ces petites villes du Canada, triste banlieue sans perspective. Comme ceux de Jeff Lemire, les personnages de Kevin Hardcastle subissent l'ostracisme lié à leurs racines indiennes.
La cage dont il est question dans le titre est celle de combats de freefight. Daniel était un combattant prometteur. Mais une mauvaise blessure au mauvais moment l'éloigna des rings un peu trop longtemps pour pouvoir espérer que sa carrière décolle. Amer et frustré, il a dû renoncer aux combats et, une dizaine d'années plus tard, le voilà ouvrier-soudeur à temps partiel, marié et père d'une petite fille qu'il adore. Sarah et lui travaillent dur, mais ce n'est pas suffisant pour vivre l'esprit tranquille.
Daniel arrondit ses fins de mois en servant d'homme de main à Clayton, un ami d'enfance devenu un caïd local. Ce n'est pas de gaieté de coeur, surtout que les méthodes de Clayon deviennent de plus en plus violentes. Le reste d'amitié que Daniel éprouve pour Clayton ne suffit bientôt plus à lui faire fermer les yeux. Il n'en peut plus et décide de claquer la porte. Mais comment échapper à cette vie ?
Daniel arrondit ses fins de mois en servant d'homme de main à Clayton, un ami d'enfance devenu un caïd local. Ce n'est pas de gaieté de coeur, surtout que les méthodes de Clayon deviennent de plus en plus violentes. Le reste d'amitié que Daniel éprouve pour Clayton ne suffit bientôt plus à lui faire fermer les yeux. Il n'en peut plus et décide de claquer la porte. Mais comment échapper à cette vie ?
 Parce que la cage du titre symbolise également celle qui retient Daniel, Sarah et Madelyn dans leur misère sociale. Coincés dans une petite ville où rien n'est possible, plombé par la mauvaise réputation que traîne Daniel de par ses origines, sa gueule démolie d'ancien boxeur, sa proximité avec Clayton, suffisante pour inspirer une forme de crainte primaire, mais pas assez pour lui permettre d'en tirer profit, limités par des moyens financiers les empêchant tout projet pour sortir de leur marasme...
Parce que la cage du titre symbolise également celle qui retient Daniel, Sarah et Madelyn dans leur misère sociale. Coincés dans une petite ville où rien n'est possible, plombé par la mauvaise réputation que traîne Daniel de par ses origines, sa gueule démolie d'ancien boxeur, sa proximité avec Clayton, suffisante pour inspirer une forme de crainte primaire, mais pas assez pour lui permettre d'en tirer profit, limités par des moyens financiers les empêchant tout projet pour sortir de leur marasme...
Daniel ne peut se défaire de l'idée que lorsqu'il pratiquait le freefight, il tenait son destin en main dans la cage. Et qu'il était un bon combattant. Hors de l'arène, il n'est plus personne.
 Kevin Hardcastle signe un premier roman prometteur. Série noire sociale portée par une écriture assez fine, essentiellement dans les quelques chapitres de flashbacks qui proposent un style intéressant, Dans la cage m'a pourtant laissé sur ma faim. Les personnages sont assez fouillés mais l'auteur a fait le choix d'une narration assez froide et austère qui impose une distance un peu trop grande entre le lecteur et les personnages.
Kevin Hardcastle signe un premier roman prometteur. Série noire sociale portée par une écriture assez fine, essentiellement dans les quelques chapitres de flashbacks qui proposent un style intéressant, Dans la cage m'a pourtant laissé sur ma faim. Les personnages sont assez fouillés mais l'auteur a fait le choix d'une narration assez froide et austère qui impose une distance un peu trop grande entre le lecteur et les personnages.Le déroulement de l'intrigue est aussi un peu trop prévisible, pour aboutir à une conclusion expédiée en quelques pages, déforçant paradoxalement ce qui aurait dû être le climax de cette histoire. Cette fin trop abrupte laisse un goût d'inachevé. Nous quittons les personnages comme une porte qui claque. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'avait jusqu'alors pas hésité à laisser se développer quelques beaux passages presque contemplatifs qui apportaient beaucoup de substance aux personnages. Je pense essentiellement à un chapitre qui suit une nuit de Sarah, qui est infirmière dans une maison de repos. Quelques très belles pages à l'atmosphère subtile qui ne s'accordent pas avec cette fin qui paraît déplacée dans la forme. Parce que dans la logique du récit, elle trouverait tout-à-fait sa place. Mais pas comme elle est exécutée. Trop vite, trop caricaturale. Un peu comme si Kevin Harcastle avait voulu traduire en roman le vertige de la fin de Taxi Driver, mais sans y arriver.
Un auteur à suivre, certainement, pour un premier roman qui souffre de défauts mineurs.